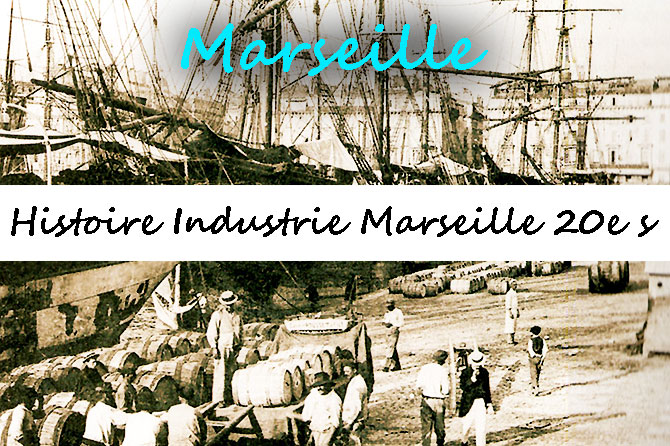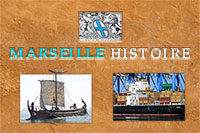1920. Marseille – Le Quai de Rive Neuve – Phototypie E. Lacour
Accueil Provence 7
Histoire de l’Industrie de Marseille au 20e siècle
- Transformations, grandes dates, industries et chefs d’entreprises de Marseille au 20e siècle.
1900 – 1914. Marseille dans la seconde Révolution Industrielle
Des conditions très favorables à l’industrie
- L’arrivée du train Paris – Lyon – Méditerranée à Marseille.
- Achèvement de grands travaux sur le tissu industriel.
- Arrivée massive de Piémontais.
- Electrification au tournant du siècle qui bouleverse les conditions de production industrielle.
- Arrivée de capitaux parisiens et lyonnais.
- 1913 considérée comme l’apogée de l’industrie à Marseille.
4 secteurs particulièrement dynamiques
- Toutes sont directement tournées vers le consommateur final.
- Savon
- Agroalimentaire.
- Blé – Semoules – Riz – Sucre.
- Tuileries.
- Plusieurs innovations techniques : Fours Hoffman à vapeur, presses verticales à 5 pans, évolutions du trafic maritime…
- Tabac.
- L’Etat est ici l’employeur.
- Questions des maladies du travail qui ne sont pas reconnues avant 1919.
- Importante main d’oeuvre féminine.
- 1887. Création du 1er syndicat des ouvriers et des ouvrières du tabac.
Progression des niveaux de vie
Secteurs en régression
- Industrie du plomb.
- Déboires de la sidérurgie et de la métallurgie à Marseille.
Secteurs émergents
- Démarrage précoce de l’industrie pétrolifère.
- Démarrage de l’automobile avec Turcat-Méry positionné en haut de gamme.
- Industrie électrique.
- Industrie de la soude stimulé par des techniques venues de Belgique.
- Engrais chimiques.
- Industrie du Soufre.
- Mines de Bauxite et production d’alumine.
Leaders
- Charles – Auguste Verminck.
1914 – 1945. Transformations en profondeur du Monde et de l’industrie
Grandes transformations industrielles dans le Monde
- Accélération forte de la mondialisation.
- Emergence de nouveaux marchés.
- Arrivée à maturité marchés.
- Déclin de certaines activités.
Dynamiques marseillaises
- Des apparences disparates et hétéroclites
- Marseille empile des entreprises de plusieurs générations.
- Les industries occupent le territoire de Marseille de manière multipolaire.
- Des lignes de force de l’activité industrielle.
- Un Port en modernisation continue et ouvert au Monde.
- Une richesse des produits et des processus productifs.
- L’industrie devient l’élément moteur de l’ensemble du tissu économique.
- 60 à 70% du trafic portuaire constitués par l’industrie qui est le principe fondateur du port.
- Modifications des approvisionnements notamment en matières premières.
- Modifications de débouchés de l’industrie.
- Majorité des productions de biens , principalement alimentaires, à faible valeur ajoutée.
- 2 grands axes d’exportations :
- Marchés outre-mer dans l’Empire français.
- Hinterland ou marché intérieur.
- Principal levier de compétitivité : qualité des approvisionnements en matières premières et stabilité des coûts.
- Secteurs majeurs.
- Minoterie.
- Longue tradition marseillaise du commerce céréalier.
- 1917. Perte de la Russie (Mer Noire), principal fournisseur.
- Nouveaux greniers à blé : Continent américain – Australie.
- Concurrence des fournisseurs qui transforment eux-mêmes leurs céréales.
- Oléagineux.
- Fleuron des industries traditionnelles qui perd ses atouts tout en résistant.
- Marseille perd la domination du négoce des oléagineux face à l’Angleterre, l’Allemagne et les Pays-Bas.
- Sucre.
- L’effondrement des récoltes betteravières du nord de la France profitent à Marseille.
- Industries mécaniques et métallurgiques qui décollent avant de manquer de souffle.
- Les 2 branches sont importantes : 25 000 emplois (18 000 pour la Chimie et 15 000 pour l’agro-alimentaire).
- Branches importantes de l’activité portuaire.
- Grands chantiers de constructions navales.
- Petits ateliers disséminés dans la ville.
- Fournisseurs des huileries, savonneries, minoteries…
- Projet de développements d’industrie lourde : électro-chimie et électro-métallurgie, industrie de l’alumine et de l’aluminium…
- Ressources hydrauliques des Alpes.
- Bauxite du Var.
- Transformation du zinc d’Indochine.
- Traitement des graphites de Madagascar.
- Renaissance d’une sidérurgie provençale, après l’échec du 19e s.
- Débuts prometteurs de l’automobile sans suivi.
- Envol de la construction aéronautique et du transport aérien.
- Essor de la construction navale et du transport maritime.
- Chantiers. Ateliers. Moteurs Baudoin…
- Chemin de fer (Coder).
- Industries chimiques en plein développement et rénovation.
- Chimie des engrais.
- Superphosphates, sulfates de cuivre et de soude…
- Poudrerie de Saint-Chamas.
- Industrie du Soufre qui se concentre.
- Décollage de la raffinerie phocéenne.
- Les Pétroles s’implantent avec l’Anglo-Persian Oil Company (APOC), future BP.
- Création d’entrepôts dans un premier temps.
- Leadership de la stéarinerie avec la firme Fournier.
- Production de détergents issus de la savonnerie.
- Traitement des corps gras par catalyse et synthèse chimique.
- Chimie des engrais.
- A noter le manque de production de biens manufacturés.
- Minoterie.
- Changements structurels sur la période.
- Déplacement de l’appareil productif vers les zones vierges de l’Etang de Berre.
- Le commerce des pétroles devient dominant à la fin des années 30.
- La rénovation industrielle est insuffisante et pas assez en profondeur.
- Petites entreprises et capitalisme de proximité dominent aux lisières de l’artisanat.
- Inertie des banques et des organismes financiers qui sont surtout spécialisées dans la gestion des dépôts de leurs clients.
- En synthèse, l’industrie de Marseille a du mal à décoller et son moteur s’enraye.
Leaders de l’industrie marseillaise
- Georges Brenier. Londres, 11 octobre 1873 – Marseille 7 mars 1956. L’homme du Pétrole à Marseille.
- Frédéric Fournier. Leader su savon et de la bougie.
1945 – 1969. Fin du système industrialo-portuaire de Marseille
Destruction du système marseillais causée par la crise portuaire
- 1945. Le port de Marseille devient un port colonial essentiellement tourné vers le Maghreb.
- La crise est d’abord cachée par plusieurs facteurs.
- Les effets de Plan Marschall.
- Les guerres coloniales en Indochine et en Algérie.
- Le dédoublement du port avec un accroissement considérable du trafic des hydrocarbures.
- Gisements du Sahara algérien.
- Golfe Persique en gestation.
- Les hydrocarbures éclipsent les autres produits importés.
- Le pétrole remplace le système marseillais de négoce et de rente.
- Le Port de Marseille réussit alors à éclipser ses concurrents de Gênes et de Barcelone.
- La prospérité est trompeuse.
- Ultra-spécialisée sur le Pétrole, Marseille perd la mesure des autres marchés d’échanges.
- Le capital marseillais passe sous la dépendance de logique étrangère.
Fin des années 1950, le système s’effondre
- Le système économique marseillais a développé un systèmes de petites et moyennes entreprises hostiles aux modernisations technologiques.
- Les profits viennent d’une pression sur les salaires plutôt que sur la valeur ajoutée et la compétitivité.
- Les investissements dans le domaine industriel sont limités afin de dégager des profits immédiats.
- Les industriels marseillais ne comprennent pas l’évolution de la division internationale du travail.
- La recherche des prix d’achats les plus bas et des petits bénéfices spéculatifs caractérisent les pratiques.
- L’autofinancement et l’absence d’investissement en recherche, en innovation… bloquent le système.
- Le Pacte colonial disparu, les réflexes de défense sont plus forts que ceux de l’adaptation.
- Marseille est concurrencée par les anciennes colonies, par le Nord de la France et par des villes étrangères.
- Les industries de corps gras et de l’agroalimentaire (raffineries de sucre, minoteries…) sont les plus affectées.
- Les difficultés du Port, des corps gras et de l’agroalimentaire entraînent des pans entiers de l’économie.
- Chaudronnerie, emballage carton, imprimerie, manutention…
- Le Bâtiment va occulter durablement ces problèmes structurels.
- L’afflux de population nécessite des nouvelles constructions.
- Exode rural.
- Rapatriés des colonies.
- Immigration nord-africaine qui fournit la main d’oeuvre.
- La fièvre de l’immobilier et de la construction ont des effets de levier qui cachent les faiblesses industrielles.
- Matériaux de construction.
- Construction mécanique.
- Engins de levage et de construction.
- Finances publiques….
- L’afflux de population nécessite des nouvelles constructions.
- Le développement de la périphérie de Marseille commence.
- Etang de Berre.
- Bassin d’Aix. Prémisses du développement.
- CEA à Cadarache.
- Aéronautique à Marignane, Istres…
Leaders de Marseille
- Edouard Rastoin.
1969 – 2000. Crises et Recomposition de l’industrie à Marseille
Recompositions sur fond de crise du capitalisme et de Marseille en plein bouleversement
- Le Monde se fracture autour des années 1970.
- Crise des économies capitalistes tenant à la régulation dite fordiste.
- Augmentation de la productivité du travail par la modernisation technologique des entreprises.
- La crise pétrolière est la cause de cette rupture.
- Les industriels répondent à la crise par la délocalisation vers les pays à bas salaires.
- Les conséquences les plus visibles sont l’inflation et le chômage.
- Crise des économies capitalistes tenant à la régulation dite fordiste.
- Les économies de l’ouest de l’Europe assistent à un autre changement majeur.
- Le désengagement des Etats.
- La montée des pouvoirs locaux, Régions et grandes villes notamment.
- Les Régions entrent en concurrence.
- Ces deux fractures majeures emportent les derniers grands groupes de l’industrie marseillaise traditionnelle.
- Les secteurs de la grande industrie, notamment implantés autour de l’Etang de Berre et de la ZIP de Fos sont confrontés à une concurrence mondiale.
- Les petites entreprises, nombreuses à Marseille, rencontrent des difficultés majeures.
- Manque de compétitivité.
- Absence des débouchés, effondrement de la sous-traitance.
- La fin du millénaire voit des signes de relance apparaître.
- Les années 1980 – 1990 sont marquées par un processus de recomposition fondamental.
- Ce mouvement s’accompagne d’un renouveau social.
- Emergence de catégories socioprofessionnelles liées aux nouvelles activités.
- Gestion des Ressources Humaines.
Evolutions sectorielles
- Changements de mains dans l’Agroalimentaire.
- La Métallurgie Marseillaise et les Constructions Mécaniques tombent de haut.
- A la fin des années 1970, ces secteurs apparaissent comme prospères et modernes.
- La Réparation Navale est le fleuron de Marseille.
- 1976. Plus de 70% de la réparation navale française.
- Marseille profite de sa place de Port Pétrolier au détriment de Lisbonne, Gênes, Naples, Palerme, Caix, Le Pirée.
- Marseille a un personne très qualifié.
- Les outils, à l’image de la forme de radoub n°10 (accueil de navires jusqu’à 700 000 tones) sont les meilleurs.
- Les accords sociaux de pointe vont se retourner contre Marseille dans un contexte de concurrence internationale.
- 1978. Le groupe Terrin est démantelé…
- 1995. Le secteur emploie 1 500 salariés contre 10 000 20 ans avant.
- La motorisation (Baudouin) et la construction navale (La Seyne et La Ciotat) connaissent le même destin un peu différé.
- Jusqu’au milieu des années 1980, les Constructions Navales de La Ciotat connaissent une exceptionnelle progression.
- La concurrence de la Yougoslavie et de la Corée du Sud bouleverse les marchés.
- Le matériel ferroviaire – la construction et la réparation de wagons et de remorques porte-chars explosent.
- Titan – Coder, créée à Aubagne par les frères Coder en 1903 est mise en liquidation en 1974.
- La Réparation Navale est le fleuron de Marseille.
- A la fin des années 1970, ces secteurs apparaissent comme prospères et modernes.
- Coup d’arrêt de la Sidérurgie à Fos avant une relance.
- Raffinage et Pétrochimie à la croisée des chemins.
⇒ La désindustrialisation entraîne la disparition de plus de la moitié des emplois industriels de Marseille.
- Illusions d’un certain Tertiaire.
- Au moment ou les activités tertiaires de haut niveau vont fonder le développement des villes les plus dynamiques, Marseille tarde a faire sa mutation.
- Marseille place ses ambitions dans un tertiaire administratif et de fonctionnement (le plus souvent public) et dans les services à la personne, plus prometteurs.
- Au moment ou les activités tertiaires de haut niveau vont fonder le développement des villes les plus dynamiques, Marseille tarde a faire sa mutation.
- Des Zones d’Activités seront finalement mises en place.
- ZAC de La Valentine – village industriel de la Valbarelle – ZAC de La Soude – Artizanord…
- Des PME se développent alors :
- Agro-alimentaire – Construction mécanique et électrique – Activités de commerce, de transite et de distribution.
- Des « friches » vont se multiplier : Saint-Henri – La Barasse – L’Estaque – Saint-Marcel – Belle-de-Mai.
- 5 groupes de Marseille résistent à la crise et auront des destins différents.
- Terrin. Groupe de réparation navale.
- Unipol. Secteur des corps gras.
- Pernod-Ricard. Boissons.
- Cohen-Skalli. Agroalimentaire.
- Comex. Nouveau-venu (1961) de l’off-shore.
Mise en place de nouveaux mondes : nouveaux secteurs géographiques, nouveaux métiers, nouvelles entreprises
- Des nouveaux territoires.
- Le modèle de Sophia-Antipolis, près de Nice, à Valbonne.
- Dichotomie Marseille intra muros / extérieur proche.
- Création de pôles : aéronautique à Marignane, IBM à Nice…
- Rôle majeur de CEA de Cadarache avec ses filiales : Technicatome – C.I.S.I….
- Pays d’Aix.
- Zone de Rousset–Peynier.
- 1961. Création par les Houillères de Provence.
- 1979. Eurotechnique, spécialisée dans la fabrication de circuits intégrés sur plaque de silicium.
- 1983. Reprise d’Eurotechnique par Thompson.
- Micropolish / Laporte – Testinnovation – IBS – ES2/Atmel …
- Parc de la Duranne.
- Z.I. des Milles. 1970.
- Europôle de l’Arbois.
- Zone de Rousset–Peynier.
- Zone des Paluds à Aubagne. 1969.
- Zone de Gémenos. 1987.
- Gemplus…
- Zone de La Ciotat.
- Zone Industreielle de Vitrolles.
- Zone de Château-Gombert.
- 1975. Transfert de l’ESIM (Ecole d’Ingénieurs de Marseille).
- 1977. Décision de développer le territoire.
- 1980. Achats de terrains.
- 1986. Institut Méditerranéen de Technologie.
- Puissant potentiel universitaire Scientifique et Médical.
- Des nouvelles secteurs et marchés.
- Profiter de l’informatique en plein développement.
- Microélectronique de la Vallée de l’Arc.
- Automatisme – Instrumentation – Robotisation.
- Bertin – Comex – Snef-Electric – Technofirst...
- Médical.
- Les cartes numériques symbolisent ce renouveau.
- Cartes téléphoniques.
- Cartes bancaires.
- Cartes de télévision à péage.
- Cartes de Santé.
- Sartes sans contact…
- Profiter de l’informatique en plein développement.
- Des nouvelles entreprises et de nouvelles implantations
- La « grande entreprise » avec son mode de production hiérarchisé, son manque de flexibilité, ses corporatismes, ses procédures est mise en cause.
- Moins de structures familiales héréditaires.
- Profiter de la croissance démographique et de ses lieux d’implantation.
- Profiter des liens techniques et scientifiques avec des réseaux d’ingénieurs.
- Développer un tertiaire supérieur.
- Nouvelles entreprises.
- Cybernetix – ONET – Dapi Equipement –
- Nouvelles implantations.
- Air Liquide (1988) – Applied material (1996)…
- Un management très différent.
- Implantation proche des nouvelles voies de communication : aéroport – autoroutes – TGV…
- Développer des réseaux de recherche, de communication…
- Faire appel à des capitaux internationaux.
- Profiter des ressources de l’enseignement supérieur et des pôles universitaires d’excellence.
- Innover.
Leaders de Marseille
- Henri-Germain Delauze.
- Marc Lassus.
- Paul Ricard.
- Pierre Terrin.
2000 – Redéploiement sur des bases et des définitions nouvelles
Les profondes mutations technologiques exigent de nouvelles dimensions
- Les frontières de l’industrie et du tertiaire sont moins nettes.
- Emergence de la Nouvelle Economie.
- Des facteurs de fond changent.
- Changement des formes de travail.
- Modification de la qualification des emplois.
- Transformation des échelles et de l’apologie du grand, du multiple et de la série…
- Remise en cause du modèle fordiste quantitatif.
- Nouvelles localisations des emplois de l’industrie.
- Le futur semble vouloir s’inscrire dans l’histoire longue de la ville.
- Importance accrue des chercheurs et des laboratoires.
- Moins d’importance accordée au Port.
- Dynamique spatiale autour de 5 grands pôles.
- Cuvette centrale de Marseille.
- Pays Aixois.
- Etang de Berre.
- Fos–Martigues. Territoire de la Grande Industrie.
- Aubagne – Gémenos.
- Dynamique spatiale autour de 5 grands pôles.
- Le département des Bouches-du-Rhône, champion de la Provence et assimilé à l’industrie, est devenu moins industrialisé que la moyenne française…
- Le Port de Marseille a perdu son leadership en Méditerranée…
- Chimie et Sidérurgie sont performants d’un environnement très concurrentiel.
- Le secteur Aéronautique est majeur en Provence.
- La Microélectronique a pris une forte dimension en Provence.
- Informatique et Logiciels ont été des champions d’innovation.
- L’Ingénierie Industrielle couvre des multiples activités : gestion de l’énergie, automatisation, instrumentation, contrôles, analyses qualité…
- Les occupations de niches se multiplient dans le Médical, les technologies de l’image…
Articles liés à Histoire de l’Industrie de Marseille au 20e siècle
- Cliquer sur l’image-lien pour afficher l’article correspondant.